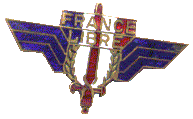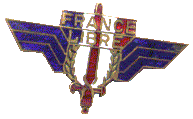Soleil délicieux commence à pointer à travers les branches. Calme du matin. Pas de SS braillards, pas de SS du tout. Une fine couche de neige est tombée dans la nuit. Seuls le bout de mon nez et mes yeux sont hors de la couverture humide, mais tiède. D'autres couvertures alentour remuent un peu, grognent. De la buée s'en échappe. Grasse matinée: j'attends que le soleil grimpe un peu plus haut dans le ciel et me réchauffe. Réchauffe aussi mes poux. Petite chasse le long des coutures, le dos au soleil: fastueux claquement du pou que j'écrase entre les ongles de mes pouces...
Dans ma poitrine croît et rayonne une petite boule de contentement: peu à peu je me rends compte que j'ai enfin gagné la guerre! J'ai duré plus longtemps que ceux qui pouvaient si facilement lancer leurs chiens contre moi, me frapper, me tuer. J'ai survécu à treize mois de vie funambulesque.
Hier encore le SS pouvait essuyer ses bottes sur moi. Le voici à présent qui fuit à travers bois, la mort et la trouille au cul, cloporte terrifié cherchant une pierre sous laquelle ramper. Moi, ça va. Je me prélasse au soleil, sans crainte.
Une voiture sur la route s'arrête au bord de notre petit bois. C'est une Volkswagen Feldjägger, une espèce de Jeep allemande. Il est évident que celle-ci a été capturée par les Russes: l'Armée Rouge est dedans, un chauffeur et un galonné.
Hourra! Enthousiasme délirant de ceux qui ont encore la force de le manifester. Moi je reste tranquille, content et las. Discours de l'officier. Quelle musique cette langue russe! Hospitalière, pleine de rondeurs solides, après l'allemand méprisant, aigre et hargneux. Mais je ne comprends pas un mot.
Un interprète dit que la petite ville proche se nomme Crivitz, qu'il nous faut y aller, ceux qui peuvent marcher - on viendra chercher les autres - qu'il y a à manger. Une bonne âme de sous-off nous harangue: "Montrons que les Français sont disciplinés, mettez-vous en rang et on va entrer à Crivitz au pas". Si quelqu'un me parle encore de discipline, je lui mettrais bien volontiers ma main sur la gueule, si j'en avais la force. Nous sommes quelques uns à marcher paisiblement à distance du régiment.
Le commandant russe est installé dans les salons du Rathaus[1], entouré de militaires, de femmes peu vêtues - certaines n'ont pas vraiment l'air contentes d'être là - de victuailles, de bouteilles plus ou moins pleines. La bonne humeur règne chez les vainqueurs. Il y a de quoi: ça n'est pas tous les jours qu'on casse les reins à un Grand Reich qui nous promettait de durer mille ans. Nous lui demandons où il a l'intention de nous héberger. "Camarades Franzouski, installez-vous où vous voulez, la ville est à vous!"
C'est gentil, mais on n'a pas tellement l'habitude d'avoir une ville à nous, et l'épuisement réduit l'envergure de notre imagination. Dans la rue, des soldats sur des bicyclettes zig-zaguent d'un mur à l'autre, l'équilibre instable, s'arrêtent pour nous offrir du schnaps. Exclamations! Grands rires!
"Hé! Les mecs, regardez!" C'est une épicerie. Une épicerie de village, pas grande, les Russes y sont déjà passés, il y a un peu de désordre et plus guère de bouteilles. Une bascule pour peser les sacs de pommes de terre. Je pèse 41 kgs. Il m'en manque 22.
On trouve des oeufs, de la farine, du saindoux, des confitures. Une énorme poêle. De quoi faire des crêpes! Vite un feu, vite la pâte. Ça colle bien un peu, ça dégouline. On bâfre. Ouf! Je n'en peux plus! On dort.
Encore une grasse matinée. Puis en route vers l'Ouest. On laisse la vaisselle pas faite. C'est agréable, un petit pillage comme ça. On a un peu fouillé dans les tiroirs, mais pas trouvé de trésor. Sauf le livret d'épargne Volkswagen.
Comme son nom l'indique, Volkswagen est la voiture du peuple. Chaque citoyen consciencieux possède un livret comme celui-ci, où il colle régulièrement les timbres qu'il achète. Avec l'argent ainsi amassé peu à peu, le gouvernement a construit une usine, les ingénieurs ont dessiné la voiture. L'efficacité allemande a tout bien coordonné: lorsque le livret est rempli, on prend livraison de sa voiture. Mais voilà: Hitler fait la guerre, et le propriétaire et sa voiture se retrouvent tous deux en uniforme. Avec un peu de chance l'un conduisant l'autre. Le livret que j'ai a la main est presque plein. C'est beau l'épargne.
On marche à travers la campagne. Une ferme. Abandonnée par ses habitants, sauf quelques bêtes. Une oie est là. Grosse. On la fait cuire? Je suis seul à savoir. Enfin, j'ai aidé à tuer, plumer, faire cuire, une fois, un poulet.
On coince l'oie, j'empoigne le cou. Elle en a vu d'autres, et me frappe le bras à grands coups d'aile, cacardant d'indignation. Aïe! Elle est forte et je suis encore bien faible. Je me retire dignement: "Elle est trop verte, et bonne pour des goujats".
Bruits de charroi, bruits de sabots, claquements de fouets, cris. De derrière un bois sort une cavalcade: des canons et leurs coffres à munitions attelés, certains en flèche, d'autres en troïka, à des centaures coiffés de bonnets d'astrakan, bardés de cartouchières, de carabines, de mitraillettes, entourés de cavaliers d'escorte. Ils galopent devant nous à bride abattue, claquant leurs fouets, et disparaissent de l'autre côté du paysage. Nous sommes au Châtelet et je viens de voir passer Michel Strogoff[2].
Épuisé. J'ai la chiasse. Trop mangé de crêpes hier soir? Ou trop de pousses de bouleau avant? Ou bien je résiste moins bien aux merdes que la guerre répand partout à foison? Je m'arrête pour dormir dans une grange, laissant les autres continuer. On se reverra en France.
Matin. Je m'approche d'un petit campement russe, dans l'espoir d'y être invité au petit déjeuner, et je manque d'être étouffé sous leur générosité! Quel plaisir d'être avec des gens qui vous veulent du bien! Même si je n'ai pas très envie de manger tout ce lard gras!
J'entre dans un village. Du bout de la rue un soldat de l'Armée Rouge, mitraillette à la main, arrive en courant, l'air agité. Il s'arrête devant moi et pointe son arme sur mon estomac. Il dit quelque chose, mais quoi? Il a perdu quelque chose? Il est soûl? Il sort d'une bataille l'esprit dérangé par les explosions? Je lui prodigue les sourires et je lui montre mon numéro matricule de concentrationnaire. Il a l'air complètement idiot, mais menaçant. Je ne vais quand même pas mourir ici, maintenant, aux mains de ce con? Il se tourne et part en courant. Ouf!
Dans un champ j'aperçois deux chevaux. L'un d'eux se laisse approcher. Il est aussi maigre que moi. Ça n'est pas très gentil de ma part, mais tant pis, je monte sur son dos pour qu'il marche à ma place. Une demi-heure plus tard je redescends. Sa colonne vertébrale, vraiment trop saillante, frotte le bas de la mienne: il ne reste plus de peau humaine au point de rencontre et j'ai trop mal.
Voici un homme fortuné: il a trouvé un cheval et un haquet, celui-ci attelé à celui-là. Il est italien, en route pour rentrer 'a casa sua'. Je lui explique pourquoi je marche à côté de, plutôt qu'être assis sur, mon cheval. Troc. Je lui donne ma bête et il me laisse m'allonger sur la plate-forme de sa charrette.
Toujours un soleil brillant. Je regarde défiler le paysage. La campagne est belle, gorgée de Printemps, si le regard ne s'attarde pas sur les endroits où les hommes se sont empoignés: camions éventrés, chars encore fumant, cadavres d'hommes et de chevaux, - il commence à faire chaud, il y a déjà des mouches - cratères de bombes. Éparpillés sur la route, diverses sortes de prisonniers, l'air content, rentrent chez eux.
La route descend vers une rivière. Pont. Sentinelle russe à l'entrée. Je descends de la voiture et je vais lui serrer la main. Spaciba! Dosvidanya! Grands sourires, claques sur l'épaule.
De l'autre côté du pont la sentinelle est américaine. Mâchant de la gomme. Je la salue en anglais, et je lui dis combien je suis content de la voir. GI Joe s'en fout et ne répond pas. Il en a sans doute marre de tous ces mecs sales. Ça ne fait rien, je suis heureux qu'il soit là.
Schwerin. Une ville au bord d'un lac, pas loin de la mer Baltique. Aux carrefours, des armes entassées: points de collecte où les Allemands vaincus doivent les déposer. Voici un centre d'accueil: une grande pièce d'où les occupants sont partis, laissant des trésors derrière eux: Colis de la Croix-Rouge américaine à gogo, certains pas même ouverts. Déjeuner orgiaque: café au lait avec de la poudre de café, de la poudre de lait et du sucre en poudre. Et une omelette avec des oeufs en poudre. Ah! L'Amérique!
Si seulement je n'avais pas une telle chiasse.
Un officier américain me dirige vers une caserne allemande réquisitionnée, où il y a une infirmerie. J'y découvre que les médecins et les infirmières sont allemands, aussi réquisitionnés. Devant mon haut-le-coeur l'Américain me rassure, serment d'Hippocrate, ce genre de discours. Merci bien, mais non merci. Je leur tourne le dos.
Dans la cour de la caserne j'aperçois une vieille connaissance: toujours aussi potelé et boiteux, le Kalfaktor du chef du Block 46. Celui qui trouvait si drôle de vous mettre son poing sur la gueule si on encombrait son chemin, et qui un jour s'était défoulé sur la mienne. L'ordure tremble de peur. J'aurais plaisir à lui foutre une raclée à mon tour, mais je n'en ai pas la force.
Il faut attendre. Les camions des armées roulent sans cesse, mais nous sommes des millions à transporter. Impatient, j'ai du mal à rester en place. Je vais au MilGov[3] voir s'il n'y a pas moyen d'accélérer mon retour. A l'intérieur du bureau, parmi les Américains, un uniforme français resplendissant, à la suffisance débordante, se pavane, marche de long en large, parle haut un anglais de lycée français. Faire la queue pour aboutir à cette caricature est au-dessus de mes forces.
Ballades dans la campagne, avec un copain, pour prendre patience. Une ferme. Et si on pillait une poule? Grosse fille pas contente, sa mère non plus, et le grand-père qui essaie de me reprendre la poule. Je lui tords le pouce pour lui faire lâcher prise. Pas solide: je sens l'os qui s'effrite sous ma main, comme un petit-beurre. Surpris, interdit. Je ne m'attendais pas à ça, casser le pouce d'un vieux monsieur. Piètre Attila, j'abandonne la poule et je m'en vais.
Enfin des camions pour nous. Ils vont à Ludwiglust, zone anglaise, et nous débarquent à la gare. Un soldat, pulvérisateur à la main, me pompe de la DDT sous les bras et dans le pantalon: il s'agit de ne pas ramener de poux avec nous. Les Américains l'avaient déjà fait, mais il insiste pour recommencer. Un autre soldat demande si nous avons des souvenirs, qu'il offre de nous acheter: insignes SS, poignards, appareils photos, etc..
A partir d'ici, le chemin de fer fonctionne. Train. On traverse la Hollande, la Belgique, sans s'arrêter. Tiens, voici Lille. Le train s'arrête le temps de nous offrir à boire et à manger. Gare du Nord. Paris.
Un autobus nous emmène à l'Hôtel Lutétia. Bon de ceci, bon de cela, voici un peu d'argent, un papier qui certifie que vous rentrez d'Allemagne. Le métro est gratuit pour les déportés, le poinçonneur me laisse passer. Les gens regardent ma veste à raies bleues et grises, et le numéro sur ma poitrine.
Il y a cinq ans, presque jour pour jour, j'enfourchais mon vélo, place de la République...