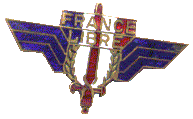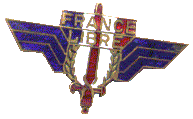| |  | | | | Chapitre sept : Geheime Feld Polizei |
| | Une traction avant[1] noire roule à peine, à ras du trottoir, et s'arrête ayant un peu dépassé le café. J'aperçois tout juste sa malle arrière, à travers la vitre, et aussitôt après, de l'autre côté, le capot de la voiture qui la suit et qui s'arrête. Elles encadrent la devanture. Bruits de portières. Les Chleuhs. De grands diables ouvrent brutalement la porte du café, s'engouffrent. Manteaux de cuir verdâtre, ceintures serrées, pointant pistolets, mitraillettes. L'air méchants, ils aboient, chiens enroués: "Police allemande!" On s'en serait douté.
Pas grand monde dans le café, trois, quatre clients, le patron, la patronne. Ils fouillent tout le monde. Sur moi ils trouvent les télés codés. "Ach! Terroriste, Monsieur! Gross filou!" Mes poignets tordus dans le dos sont pris par des menottes. Une demi-douzaine de baffes en pleine poire.
La fouille du café continue: il semble qu'il leur manque quelque chose. Sans doute n'étaient-ils pas venus pour moi? Ma présence dans ce café était due au hasard, ou presque. J'y venais rarement, seulement s'il me fallait attendre un train.
Ils me jettent hors du café, m'enfournent sans ménagement dans une des tractions. Traversée de Lille. Passants indifférents. L'épée de Damoclès vient de me tomber sur la gueule et je contemple le désastre.
Dans le café, j'ai eu quelques secondes entre ma perception de l'arrivée des voitures et l'entrée des Allemands. Je n'ai pas réagi. Peut-être y avait-il moyen de s'échapper par l'arrière du café ou par les étages, là où il y avait les chambres de l'hôtel? Je suis resté planté là comme un sac de pommes de terre...
Où donc sont passés ces réflexes qui, jusqu'ici, m'avaient tiré d'affaire? Fatigue, découragement, lassitude après vingt mois de clandestinité? Le sentiment que la chose était devenue inévitable, que ça ne valait plus la peine de lutter?
La voiture s'arrête. On m'entraîne à l'intérieur d'un grand hall. Une chaise au centre d'un mur. On me plante dessus. Ça fait jeu de massacre. Il ne manque qu'un bateleur: Approchez! Approchez! Cinq boules pour deux francs!
Va-et-vient incessant de civils et de militaires. Phrases en allemand que je ne comprends pas. Sentinelles armées de mitrailettes, des 'Sten guns', celles qu'on nous parachute d'Angleterre: ils nous les ont piquées.
Un groupe d'hommes vient d'entrer. Ceux-là parlent français. Les acolytes de l'envahisseur m'aperçoivent, viennent à moi, grossiers. Insultes. Vilains gros mots. Un dicton anglais me revient: "Sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me"[2].
Flac! Une baffe énorme m'enlève de la chaise et me jette à terre. Je me relève et me rassois. Une autre dans l'autre sens me jette de l'autre côté. Et une autre. Et encore. Je trouve ce jeu con. Enfin ils se lassent. Je ne les reverrai plus. C'était, comme ça, un petit délassement en passant.
La tête en feu, je reste là, assis, menottes toujours dans le dos, à attendre ce qui sera sans doute bien pis. Fuir l'horreur dans la mort? Il y a belle lurette que j'ai égaré ma pilule létale. L'utiliserais-je, si je l'avais? Sans doute pas encore. J'ai la trouille, mais ça n'est pas encore la panique. Ma cervelle, paralysée lors de mon arrestation, semble tourner à nouveau. Tout de même, j'aimerais bien l'avoir, cette pilule, au cas où il leur viendrait à l'idée que je sais quelque chose que je ne sais pas...
C'est mon tour. Nous sommes dans une grande pièce. Des chaises, des tables. Des Chleuhs m'entourent, menaçants. Vraiment des sales gueules. L'un d'eux a une grande balafre en travers de la joue. Mon atout, comme toujours, c'est d'avoir l'air jeune. Je me fais aussi petit garçon que possible. Je n'ai aucun mal à paraître terrorisé. "Terroriste, monsieur! Qu'est-ce que vous faites dans ce café? - J'attendais mon oncle, à qui je devais remettre les télégrammes, et je commençais à m'étonner d'avoir à attendre si longtemps. - Vous êtes un bandit, un terroriste! -Oh non! J'aurais bien voulu faire de la résistance, mais je suis malade, j'ai des crises d'épilepsie, alors on ne peut rien me confier. Seulement, quelquefois, quand on ne peut faire autrement, on me donne un courrier à porter..."
Je suis secoué de tics et de mouvements nerveux. Mes "symptômes", bien sûr, n'en sont pas. Je n'ai pas vu d'épileptiques depuis l'hôpital prison de Pampelune, et alors l'idée ne m'était pas venue que le jour viendrait où j'aurais besoin de les imiter: je ne les avais pas étudiét attentivement.
Mais mes Chleuhs, eux, n'en ont sans doute jamais vus. Il s'agit pour moi de faire diversion, de gagner du temps (essayez de tenir trois jours, disaient-ils à l'entraînement...). Ils ont l'air un peu dégoûté. Ce sont des héros, prêts à affronter les pires combats, mais un malade... Ils pourraient attraper quelque chose...
Où est-ce que j'habite? À Paris, au 36 avenue Junot. C'est l'atelier de Daniel Cordier, qui est parti pour l' Angleterre à la mi-mars[3], et j'y habite encore lorsque je suis à Paris. Ça ne devrait pas faire de dégâts. Encore quelques questions, et des baffes. Mais le coeur n'y est plus. Mon histoire, pour l'instant, tient. Mon air de franchise effrayée a endormi leurs soupçons. Je ne suis, de toute évidence, que menu fretin, un pauvre gosse pris un peu par hasard dans leur filet et qui leur fais perdre un temps précieux: ils ont d'autres terroristes à fouetter. On m'embarque pour Loos.
Au milieu des champs, au bout d'une longue avenue, la prison de Loos n'est guère accueillante. Sinistre grande porte qui s'ouvre à l'arrivée de la voiture, et qui se referme derrière elle. Rotonde d'où partent en étoile les bâtiments de cellules que l'administration pénitentiaire française et les Allemands se partagent en frères. Résonance de caveau. Le greffe de l'aile allemande est tenu par des soldats. À la demande de l'un d'eux, je lui abandonne ma ceinture, ma cravate, mes lacets, et le contenu de mes poches. Il met tout dans un sac après en avoir inscrit le détail sur un registre. Un de ses collègues me fouille, s'assure que je n'ai rien oublié. L'endroit serait calme, feutré, n'était un gueulard de feldwebel, au visage de hyène, aux bottes qui martèlent le ciment du sol.
On me donne un numéro de cellule, une paillasse, une couverture, une gamelle, et une cuillère. Portant mon fardeau, retenant mon pantalon sans ceinture, traînant les pieds pour ne pas perdre mes souliers sans lacets, je suis le soldat qui me mène. Tiens! Lui est en pantoufles. Escalier. Passerelle. C'est au deuxième étage. Ils sont déjà quatre dans la cellule lorsque j'y entre. Surprise: il y a là André Paternôtre, un fermier de Landrecies, de l'équipe Robert, chez qui j'émettais parfois. Je ne lui fais aucun signe de reconnaissance, en espérant qu'il aura l'esprit de résister à la tentation d'accueillir un ami. Il comprend et ne bronche pas.
Cinq mètres de long, deux mètres cinquante de large, les murs blanchis à la chaux sont plutôt sales, une pile de paillasses et de couvertures dans un coin, - j'y pose ma contribution - une table attachée au mur par une charnière, cinq tabourets, un lavabo avec un robinet d'eau froide, des chiottes dans le coin à droite de la porte, avec au-dessus deux triangles de bois formant étagères, deux autres dans le coin gauche, un judas dans la porte, une fenêtre, haute dans le mur, avec des barreaux, et en dessous une bouche de chauffage central qui, bien sûr, ne chauffe pas. Au plafond une ampoule: l'interrupteur est à l'extérieur de la cellule.
Indiscrétion: " Pourquoi t'es là?" Discrétion: "Je sais pas, ils m'ont ramassé dans un café, j'ai pas compris." J'entends de temps à autre à travers la porte des phrases criées en allemand. Mes nouveaux compagnons m'expliquent: on appelle les détenus à l'instruction de leur affaire, c'est-à-dire à l'interrogatoire. D'abord le numéro de cellule, puis le nom du type, écorché, puis: "Vernehmung!"
Bruits de bidons, portes qu'on ouvre et qu'on ferme, au loin. Ça se rapproche. C'est à nous. Soupe du soir. Je donne la mienne aux autres. L'angoisse est trop forte pour que je puisse manger. Paternôtre et un des gars ont reçu des colis de chez eux. Ils partagent scrupuleusement, et distribuent un petit supplément à chacun. L'accent du Nord est chaleureux: "Minge! Che t'f'ront du bien! - Non merci, sans façon, je peux pas."
Il faut se déshabiller pour la nuit. Crescendo des bruits de serrures. Notre porte s'ouvre. Il faut mettre les tabourets dehors, sur la passerelle, les vêtements empilés dessus, les chaussures à côté. La porte se referme. On étale les paillasses, on déplie les couvertures. La lumière s'éteint au bout d'un moment. Bonne nuit! J'ai les yeux grands ouverts dans le noir. Angoisse. Léger bruit. La lumière s'allume. Un oeil est dans le judas. C'est la Werhmacht qui chasse, en pantoufles pour ne pas faire de bruit et ainsi surprendre ses proies.
Au matin - il fait à peine jour - une porte au loin s'ouvre, se ferme. Puis une autre. Le bruit se rapproche peu à peu, et c'est notre tour. On reprend possession des tabourets et des vêtements. Et ça recommence au loin, bruits de bidons en plus des bruits de serrures. Ils arrivent à la cellule voisine, puis à nous: c'est le petit déjeuner. À chacun une boule de pain et une louche d'un liquide noirâtre qu'ils appellent café, mais c'est un mensonge.
On se lave, on lave la cellule, soigneusement. Ça ne fait pas de mal d'être propre, et ça aide à faire passer le temps. La litanie des Vernehmung reprend: "Fünf und sechsich! Herunter! Vernehmung!" Le récitant traîne sur le "neh": "Verneeeehmung!"
Bruits dans la serrure. La porte s'ouvre. Pointe d'angoisse. Chacun se demande si c'est pour lui. Le soldat s'écarte pour laisser entrer un rouquin dans la cellule, referme la porte. Nous sommes à présent six. Plein d'assurance, le nouveau. Bavard, il nous raconte ses exploits: parachutages, armes qu'il vend un bon prix. "Et chez vous, combien on demande pour un pistolet?" C'est un mouchard, mais quels gros sabots! Il espère sans doute provoquer une réponse indignée: "Nous, on ne fait pas ça pour de l'argent!" Personne ne trébuche. On le regarde, l'air aussi bête que possible. Il est évident qu'on ne sait pas de quoi il parle.
Les jours passent. M'aurait-on oublié[4]? Les aurais-je convaincu de mon peu d'importance, pauvre malade jeune simili-courrier? Je suis soulagé d'avoir déjà tenu plus de trois jours, mais l'angoisse ne me lâche pas, et je ne mange toujours pas. Pourrais-je jeûner à en être malade? Malade, on vous transfère à l'infirmerie, et dans les récits d'évasion, c'est souvent de là que le prisonnier s'évade.
On vient chercher notre mouchard. Sans doute pour aller exercer son art dans une autre cellule. La porte se ferme, s'ouvre un peu plus tard. Colis pour Paternôtre, du linge propre, de la bouffe. Il rend son linge sale, où de petits messages, écrits sur du papier à cigarettes, ont été glissés dans les ourlets: "Je vais bien, le moral est bon". Exploration des ourlets du linge propre: "Courage! On pense à toi, les Alliés avancent!"
Dans la nuit du 9 - Pâques! - au 10 avril 1944: Alerte! Sirènes sinistres hurlent. La DCA, hargneuse, jappe au loin. Bruit de moteurs d'avions nombreux qui se rapproche. La DCA aboie tout près. La gare de triage de Lille-La Délivrance est à côté. La cible de ce soir?
Les fusées éclairantes, suspendues à leur parachute, illuminent jusqu'au fond notre cellule. Raffut général, d'où naît, va croissant, la plainte hurlée des bombes dans leur chute - quel ingénieux ingénieur a imaginé d'ainsi ajouter à l'explosif et aux éclats d'acier qui vont déchiqueter le corps de sa victime, ce bruit pour d'abord effrayer son âme?
Humour anglais, cette distribution d'oeufs de Pâques? Éclairs, tonnerre des explosions. FLAC! Ça vous coupe le souffle. Les vitres de la fenêtre ont volé en éclats, emportant le châssis, mais les barreaux restent intacts. Hurlements encore plus forts, plus menaçants - comment est-ce possible? - CETTE FOIS C'EST POUR MOI! Les bombes éclatent au pied du mur, sous notre fenêtre, dans la cour. Indicible, les mots sont trop faibles, pas faits pour ces choses-là! Gigantesque claque qui secoue, fend, déplâtre les murs - massifs heureusement! - de la prison, qui enfonce la porte, qui me jette dans un coin les oreilles giflées, cherchant ma respiration, qui remplit l'air de fumée, de poussière. J'ai tiré une paillasse par dessus moi. Recroquevillé, coincé, je suis sans défense. Pour la première fois j'ai vraiment peur: la panique. Rien dans ma tête, ni dans mes mains ne me donne prise sur ce qui se passe...
Enfin le vacarme diminue, la poussière se pose, la lumière rouge des incendies remplace le bleu électrique des fusées éclairantes suspendues à leurs parachutes. Par la porte défoncée, je sors sur la passerelle. Brouhaha. Beaucoup de cellules ont leur porte endommagée. Des détenus circulent partout mais pas d'Allemand visible. La grande grille, au fond du bâtiment, est indemne. Le souffle des bombes est passé à travers les barreaux. Il n'y a pas de trou assez gros pour me laisser passer... |
| | Photo aérienne de Lille, prise le 11 Avril 1945 à 16:15, après le bombardement de la nuit du 9/10 Avril.
La prison de Loos pourrait être le bâtiment en bordure de photo à gauche, sous la route (?). |
| | Les Chleuhs reprennent leur prison en main: réparations de fortune sur les portes crevées, corvées de ramassage des gravats. Personne ne s'est évadé d'ici, mais le "téléphone" dit que les bombes, de l'autre côté, chez les Français, ont ouvert la prison et que certains en ont profité.... Les murs de notre cellule sont fissurés, on cloue des planches sur la porte, je ne me plains pas de la fenêtre arrachée: un peu d'air frais dilue l'odeur d'humanité entassée. Et ça repart: Vernehmung!
VERNEHMUNG! |
| | "Nothing in the world was so bad as physical pain.
In the face of pain there are no heroes, no heroes..."
George Orwell, 1984 [5] |
| | Dix jour après mon arrestation, c'est mon tour. On me sort de la cellule, puis de la prison, menottes aux mains. Voici la maison du premier jour. J'ai appris qu'il s'agit de la GFP - Geheime Feld Polizei - le service de contre-espionnage de l'armée allemande, qui serait moins bestial que le SD - Sicherheit Dienst - son synonyme du parti nazi. Pourtant ils n'ont guère l'air rassurant, lorsqu'on me pousse dans la pièce, à me regarder comme s'ils m'en voulaient. L'un d'eux tient un nerf de boeuf[6] qu'il ploie entre ses mains. Le balafré est là: "Vous terroriste, Monsieur! Vous gross filou! Monsieur vous mentir! C'est vous radio de Londres, c'est vous JEANNOT[7]! Nous savons tout!"
Aïe! Quelqu'un m'a identifié, peut-être lorsque je me promenais sur les passerelles, le matin après le bombardement? Ils n'ont pu inventer cela. "Non, mais non, voyons, vous faites erreur!..."
Une main me prend la nuque, me plaque le visage contre la table: plié à angle droit, j'ai les fesses en figure de proue. L'Allemand au nerf de boeuf me les cingle, à toute volée. Les trois premiers coups sont supportables, puis la douleur escalade exquisément. Je gueule. Je hurle de douleur. Ça atteint l'insoutenable. Un dernier coup et je craque: "OK, c'est moi le radio".
Sourires béats des Chleuhs, qui se congratulent, plient et caressent le nerf de boeuf en rigolant[8]. Ils veulent savoir d'où j'émets. J'explique que si j'avais encore les télégrammes en poche, c'est que je n'ai pas eu l'occasion de les envoyer, que je n'arrive pas à organiser un lieu d'émission et à obtenir le matériel nécessaire. C'est leur faute, ils arrêtent trop de monde, on travaille dans des conditions impossibles. Tiens, ça chatouille leur sens de l'humour. Et l'adresse de mon patron? À Paris. Mais encore? Je hausse les épaules: nous sommes des soldats de la France Libre, pas des résistants bavards. Ils ne croient tout de même pas que mon patron va me dire où il habite? En plus c'est vrai.
L'un d'eux, l'oeil et la bouche mauvais, veut savoir pourquoi je hais les Allemands, pourquoi je me bats contre son Grand Reich qui fait tant de sacrifices pour nous protéger du Bolche-visme. Je le rassure: je ne hais personne, mais lui, que ferait-il si les rôles étaient renversés, si j'étais en occupation chez lui? Que je lui prête des sentiments patriotiques a l'heur de lui plaire. L'atmosphère se détend un peu. "Vos papiers sont faux!" Pour montrer ma bonne volonté, je l'admets avec alacrité. "Qui les a faits? - Ils ont été fabriqués en Angleterre, mais je n'ai pas rencontré leur auteur." Bien sûr, ça n'est pas vrai, - ce sont ceux de Dieulefit - mais mon air de franchise fait bonne impression. Ils semblent contents d'eux, et me renvoient à Loos.
Je marche péniblement. J'ai mal au cul, au dos, aux jambes, mais surtout à moi. Aux mains de ces gens, je suis devenu un objet sans valeur, qu'ils jetteront sans doute bientôt. Le plus minable d'entre eux peut m'insulter, me frapper, me tuer. Ma volonté n'a prise sur rien. Je n'existe plus. De retour dans la cellule, je m'allonge sur le ventre, dans un coin. Les autres sont gentils: paroles de sympathie, d'encouragement.
Bruits de serrure. C'est encore pour moi. C'est trop. Je me lève avec difficulté. Il faut faire face. Sur la passerelle un homme rit. Visage de rat. "Alors c'est vous le radio JEANNOT? - Oui - Vous étiez à Landrecies, chez le vétérinaire? - Oui - Je suis bien content que vous soyez pris. Je regrette que ça ne soit pas nous qui vous ayons arrêté."
Pas moi. Ce type, pas plus grand que moi, me fait peur. "Surtout, ne dites pas à ceux qui vous interrogent que je vous ai parlé." Je trouve ça drôle. Je vais sans doute avoir besoin de sujets futiles pour remplir les interrogatoires, et si en plus je peux les amener à se disputer entre eux!
Il s'en va et je rentre en cellule. Les autres ont reconnu Walter Paarmann, du SD. Méchant, disent-ils. Il paraît qu'il y a rivalité entre la GFP et le SD. |
| | Walter Paarmann, Kriminal Inspector, SD Lille. Photographié avec ses acolytes Verbrugghe et Rosendael dans une prison néerlandaise de Heerenveen.
Après avoir quitté Lille le 2 Septembre 1994, Paarmann continua son activité policière en Hollande où il fut jugé pour crimes de guerre (condamnation inconnue). |
| | Verbrugghe, interprète au SD de Lille, acolyte de Paarmann |
| | Rosendael, chauffeur/tortionnaire au SD de Lille, acolyte de Paarmann |
| | A peine allongé de nouveau, - bruits de serrure - voilà qu'on m'appelle encore. J'en ai vraiment marre. "Komm! Affaires mitnehmen!" dit le soldat. "Prends tes affaires", me traduit un des autres, mais j'avais compris. Adieux aux copains: "Bon courage! Au revoir!"
"Los! Los! Mensch[9]!" dit le soldat. Mon dos est à présent si douloureux que j'ose à peine marcher. Le soldat me regarde, sans rien dire, ne me bouscule pas. Arrivés à une passerelle transversale, nous passons de l'autre côté. En face, il ouvre une porte, avec le numéro 52, et me fait signe d'entrer. C'est une cellule vide. J'étends la paillasse. Je m'endors. Un bruit de serrure me réveille: c'est la soupe. Je ne bouge pas. La porte se referme. Je frissonne. La fièvre, sans doute. Bruit de serrures au loin, qui se rapproche. Vite, il faut se déshabiller: j'ai le corps figé de douleur. Je regarde: mes fesses sont noires, vertes et rouges. La porte s'ouvre. Je pose sur la passerelle mon tabouret, vêtements empilés dessus, et mes souliers à côté.
Épuisé, je m'endors à nouveau. Au matin, j'accepte le "café", que je bois, et le pain, que je mange. Mon estomac s'est dénoué et j'ai faim. L'angoisse est remplacée par une certitude: je serai bientôt fusillé. L'idée ne me cause pas de gêne particulière. La chose est tellement évidente. Depuis toujours je lis des histoires de guerre: on y meurt beaucoup.
Je contemple mon horizon de murs. Cette cellule est semblable à l'autre, la solitude en plus, la promiscuité en moins: personne pour regarder et subir lorsque je satisfais mes besoins. Elle n'est pas très propre: j'empoigne la serpillière. Gestes mesurés: mon dos et mes cuisses sont si douloureux. Quelques "Vernehmung!" de l'autre côté de la porte, mais la matinée reste calme.
Tabouret sous la fenêtre, je grimpe et je regarde. À gauche, un bâtiment fait angle avec le nôtre. Il en vient des voix de femmes. En bas, une cour avec de l'herbe, bordée d'un haut mur. Une sentinelle allemande, fusil à l'épaule, s'y promène. Elle parle avec quelqu'un que je ne vois pas. Le soleil d'avril est doux à mon visage.
Bruits de bottes. On court sur la passerelle. Bruit de serrure. Ma porte s'ouvre. Chien Hargneux, le feldwebel, est là, m'engueule, longue tirade en allemand.
Je finis par comprendre que:
1) la sentinelle de la cour lui à fait savoir que je regardais par la fenêtre: c'est interdit. Si je désobéis la sentinelle me tirera dessus et on me mettra au cachot;
2) lorsque la porte s'ouvre, je dois me mettre debout, au garde-à-vous, au milieu de la cellule;
3) il est interdit de s'allonger sur la paillasse dans la journée.
J'ai bien cru qu'il allait me frapper, mais non, il s'en va. Je suis surpris par le peu d'émotion ressentie. Je m'endurcis? Au loin le crescendo des bidons et des serrures. J'accepte la soupe, bouillie de légumes et de pommes de terre.
L'après-midi, Vernehmung - loterie néfaste - tire mon numéro. Angoisse. Le parcours est différent. On suit un long couloir. Une flèche à gauche indique l'infirmerie. On continue tout droit. On croise un groupe de prisonniers, serviette autour du cou, cheveux mouillés. Au bout du couloir, un autre angle droit, puis couloir plus large. Sur la gauche, les douches. À droite, le soldat ouvre une porte et me dit d'entrer. Une table, des chaises. Un homme aux cheveux grisonnants, en uniforme, quelques galons, est assis à la table. Souriant, il me fait signe de m'asseoir. Il parle un français hésitant. Est-ce que je parle anglais? Oui. Ça lui fait plaisir de parler anglais: il a longtemps vécu au Canada. Il est chargé de mon dossier. Il espère que nous pourrons nous conduire en gens civilisés. Il déteste avoir recours à ces autres, si brutaux.
Il faut que je lui raconte ma vie, depuis ma naissance. Que je sois enfant "naturel" le chiffonne: "Votre père était peut-être juif? - Je ne l'ai pas connu, mais moi j'ai été baptisé à l'église de Passy." De m'être ainsi vivement défendu d'être juif me cause une gêne. Je ne voudrais pas me mettre aux côtés de la persécution officielle, même si je suis encore empreint de l'antisémitisme ambiant de mon adolescence.
Il m'apprend qu'ils ont arrêté Raymond Fassin, mon patron, à Paris, ainsi que Solange, sa secrétaire, et qu'elle attend un bébé. Naître en prison de parents qui risquent d'être fusillés d'un jour à l'autre...
Etudes? Je m'étends sur les difficultés rencontrées par la mère célibataire dans l'élevage de son enfant, les changements de pension et d'école, le lycée Janson de Sailly, l'école en Angleterre, l'école de TSF, le manque d'argent qui interrompt les meilleurs projets...
Confrontation, un jour, avec le couple du café-hôtel où j'ai été arrêté. Pas heureux, eux non plus... Lui, on l'appelait "l'Anglais" parce qu'il avait un crâne presque chauve au dessus d'une figure longue, et les dents un peu chevalines... J'avais deux ou trois fois attendu l'heure de mon train dans leur bistro. Et en arrivant d'Is-sur-Tille, nous avions tous dormi dans l'hôtel pour notre première nuit à Lille. Comme clients: je ne sache pas qu'ils aient appartenu à un réseau. Les Allemands lors de leur descente semblaient chercher quelqu'un ou quelque chose de précis... Y étaient-ils mêlés? |
| | Est-ce que je possède une arme? Oui, j'ai un pistolet, quelque part. Où? Sans doute sur le haut d'une armoire, mais je ne sais plus où. J'y pense rarement. M'en suis-je servi? Et surtout, m'en suis-je servi contre un Allemand? Non, bien sûr, je suis radio, me promener avec un pistolet me fait courir un risque inutile. Apparemment, ça lui paraît plausible.
Lui aussi veut savoir pourquoi je combats l'Allemagne. J'ai été élevé comme ça, nourri d'histoires de guerre, ma mère a fait l'autre comme infirmière, que ferait-il si son pays était envahi? Pour lui aussi c'est une bonne réponse: il se rêve sans doute résistant à l'envahisseur, et l'image lui plaît. Retour à la case départ.
Bruits de serrure qui s'approchent. Soupe du soir. J'écoute à la bouche du chauffage central, à la fenêtre. Les gens s'appellent, se passent des messages, s'encouragent. Les femmes de l'autre bâtiment sont des interlocutrices désirables. Parfois les sentinelles dans la cour gueulent. La nuit tombe.
Les jours se suivent, semblables, j'en perds le fil. Plaisir du soleil, le matin des beaux jours. Au milieu d'une matinée, bruits de serrure, la porte s'ouvre. Un soldat m'appelle et me fait signe d'aller par là, vers un détenu debout près d'un tabouret, des ciseaux à la main. C'est le coiffeur. Il me coupe les cheveux, puis me rase. C'est vrai que j'étais devenu un peu hirsute. Retour à la cellule.
Juste avant de me laisser rentrer, le soldat a ouvert la porte de la cellule voisine, à gauche de la mienne. Son occupant en sort et va vers le coiffeur: c'est CYPRIEN, le courrier de Deshayes! Celui qui m'apportait à Landrecies les télés de son patron!
Dès qu'il rentre dans sa cellule, je l'appelle par la fenêtre. Je suis heureux d'avoir quelqu'un avec qui échanger quelques mots. Lui a été arrêté par le SD. C'est sans doute la rivalité entre les deux polices qui nous vaut la chance d'être dans des cellules voisines, alors que chacune d'elles veut son prisonnier isolé.
Bruits de serrure qui démarrent au loin. Tiens? Ça n'est pas l'heure - à mon cadran solaire: l'ombre des barreaux sur le mur de la cellule - d'un repas. Ma porte s'ouvre: deux soldats allemands, un prêtre, deux dames à croix rouge, encadrant un panier. Le panier, grand, qui d'habitude sert à la distribution du pain, est plein de colis. Pas le droit de parler. Le prêtre me bénit, une dame me donne un colis. Échange de leur regard apitoyé contre le mien reconnaissant pour ce signe qui indique que j'existe - tout de même - un peu.
Ce colis de la Croix-Rouge - pain d'épice, pâte de fruit, biscuits, chocolat - fait des vagues sur l'ennui quotidien. Je perçois des éclats de voix. On dirait que ça vient de la cellule de droite. Je colle l'oreille au mur. Stupeur! Ce mur épais qui semblait ne rien vouloir laisser passer est un excellent véhicule du son lorsqu'on y colle l'oreille!
Vite à la fenêtre: "CYPRIEN! Va dans le coin des chiottes, colle ton oreille au mur!" Aussitôt dit, aussitôt fait. Béatitude! On peut se parler sans crier, presque comme si on était dans la même pièce. Plus de risque de se faire prendre à la fenêtre, et on est dans un angle mort de la vision du judas. Fantastique sentiment de victoire sur l'ennemi: c'est nous les plus forts!
Longues conversations. À Landrecies, je l'avais connu superficiellement, le temps de prendre les messages qu'il apportait; parfois, entre deux trains, un repas ensemble avec la famille Robert. Il est capable, lui aussi, de rire des choses sérieuses! On se raconte l'un l'autre.
Son vrai nom est René Bigot, il est arrêté sous celui de René Boyer. Il est né à Alençon, il est plus jeune que moi d'un an. Il est normalien, mais a quitté la rue d'Ulm pour le BOA. Le SD qui l'a arrêté est un tas de brutes, heureusement pas très intelligentes. Il rit de la manière dont il leur a joué la comédie du noyé lorsqu'ils l'ont passé à la baignoire pour le faire parler: excellent nageur, il a l'habitude de l'eau et s'y trouve comme un poisson!
Il sait l'allemand, qu'il commence à m'apprendre. Si bien qu'au bout de quelques semaines, un garde m'accusera, mi-rigolard, d'avoir caché mon jeu lorsque je disais ne pas du tout comprendre sa langue.
"As-tu lu La République de Platon? - Non - Vernehmung me fait penser à une histoire qu'il y raconte: Dans une caverne, éclairée par un grand feu, des prisonniers sont enchaînés de façon à ne voir qu'un mur sur lequel sont projetées les ombres des personnages qui passent devant le feu. Ces ombres sont les seules informations dont disposent les prisonniers sur la réalité qui est derrière eux."
"Nous sommes ces prisonniers. Les Vernehmung, les bruits de serrures que nous entendons sont les ombres de la réalité qui nous attend à l'autre bout de notre caverne, ce long couloir qui mène à l'interrogatoire. Mais la comparaison s'arrête là. Les prisonniers de la caverne de Platon, eux, sortent vers la lumière..."
Un autre jour: "Sais-tu jouer aux échecs?" Je ne sais pas. "Veux-tu apprendre?" Lorsqu'un soldat ouvre ma porte je lui dis vouloir écrire à mon enquêteur. Il m'apporte, quelque temps après, une feuille de papier et un demi-crayon. Je pousse et sors la mine de son enveloppe de bois. J'en brise les deux extrémités, je les remets en place, le vide au centre est comblé par de la mie de pain. Sur le papier, j'écris un petit mot à celui qui m'interroge: "Je m'ennuie. Pourrais-je avoir des livres? Peut-être une méthode pour apprendre l'allemand?" Il était temps, le soldat est déjà là pour réclamer son crayon et ma lettre.
Bénéfice de l'opération: la partie centrale de la mine de crayon, prélevée entre les deux extrémités. Puis un peu plus tard, un livre: Histoire de l'Amérique du Sud, dans lequel j'apprendrai quel homme admirable fut Simon Bolivar.
Etre debout sur les chiottes me permet de voir le dessus de l'étagère la plus haute. J'y dessine un échiquier avec mon morceau de mine de crayon, selon les instructions de CYPRIEN. Avec de la mie de pain prélevée sur la boule du matin, bien pétrie, je modèle deux rois, deux reines, quatre fous, quatre cavaliers, quatre tours, et une ribambelle de pions. La moitié est trempée dans le "café" pour lui donner une différence de couleur. Il faut attendre que ça sèche.
L'échiquier est prêt. Deux coups sur le mur. CYPRIEN m'explique alors où va chaque pièce, ce qu'elle peut faire, et nous jouons notre première partie. Et puis une autre. On peut abandonner une partie et la reprendre à volonté: l'échiquier n'est pas visible de l'indiscret fouineur debout sur le sol: il faut grimper sur les chiottes pour le voir. Fasciné, j'en oublie parfois que je suis en prison!
Les Chleuhs, cependant, n'oublient pas. Chien Hargneux, en tournée d'inspection, m'a sans doute entendu annoncer: "Fou sur A5", regarde par le judas, vois une cellule vide puisque je suis dans l'angle mort.
Bruit de serrure urgent. Lorsqu'il entre, je finis de reboutonner ma braguette, debout à côté des chiottes. Lourdaud, soupçonneux, il rôde et renifle, mais ne détecte rien. Je me suis mis debout au garde-à-vous sous la fenêtre, juste ce qu'il faut de crainte affichée dans mon attitude. Mais c'est lui qui perd cette partie-là. Comment dit-on échec et mat en allemand? La partie sérieuse reprend.
CYPRIEN m'enseigne différentes entrées de jeu, plusieurs manoeuvres, mais, bien sûr, il gagne toujours! Enfin vient le jour où je me sens suffisamment à l'aise sur mon échiquier pour sortir hors des rails et ne plus respecter ce qu'il convient de faire. Je lance mes troupes hors des sentiers battus, un peu au hasard, pour créer la surprise. Et je gagne!
Vernehmung m'appelle de temps en temps. Il veut que je lui raconte la radio. D'abord en Angleterre. Ça fait deux ans que j'y suis passé et je n'ai aucun scrupule à raconter, inventant au besoin des détails pour faire durer le plaisir, tout sur l'école d'entraînement. Ce secret de polichinelle ne vaut pas la peine que l'on se dispute. Landrecies l'intéresse moins: les arrestations là-bas sont le fait de la concurrence et ça n'est pas très rentable pour lui.
Il n'est pas pressé. Bavarder, pratiquer son anglais avec un détenu à Loos est sans doute préférable aux empoignades avec l'Armée Rouge sur le front de Russie. Il me dit sa vie au Canada. Il représentait une firme allemande. Et sans doute un peu aussi les services de renseignements du Reich.
Il me raconte ses succès: il retourne des agents, y compris des radios, et par eux obtient des parachutages de Londres! Bien sûr il se vante, et je n'en crois rien[10].
"Ça vous intéresserait de travailler avec nous?" Je rigole: "Vous auriez confiance en moi?" Il rit aussi et ne m'en parle plus. Plus tard je me dis que j'ai peut-être loupé là une occasion de m'évader.
J'avais espéré d'autres confrontations, peut-être avec Fassin, ou Solange, pour avoir l'occasion de les voir. Je n'étais détenteur d'aucun gros secret, et une fois ma condition de radio bien établie - qui n'avait vu passer que des télés codés - la tension des interrogatoires avait baissé.
"Nous allons à Paris," dit-il un matin. Dans la traction avant qui nous emmène je retrouve Janin, l'autre radio de notre mission, celui qui recevait le Broadcast. Je ne savais pas qu'il avait été capturé. Trois Allemands, dont mon interrogateur, nous accompagnent, et nous déposent rue des Saussaies, où l'on nous enferme pour la nuit dans des cellules séparées.
Le lendemain, sur le bureau de l'Allemand qui me reçoit il y a un nerf de boeuf. Je prends une mine craintive. L'Allemand sourit, saisit le nerf de boeuf et le glisse dans un tiroir. Il me dit de ne pas avoir peur. La sensation du pouvoir doit lui être agréable, si j'en crois la fatuité du sourire. Mais comme je lui ai fait comprendre que je le craignais, il ne lui est plus nécessaire de me frapper. Il veut que je lui répète ce que j'ai dit à Lille, mais en plus succinct: il est pressé. Je repasse sur l'Angleterre, le réseau de Landrecies qu'ils ont démoli en janvier, et sur les difficultés rencontrées par mon patron pour en reconstruire un nouveau. Mon ignorance du contenu des télégrammes qui passaient entre mes mains, toujours codés.
Encore une nuit en cellule. On me refait - peut-être - le coup du mouchard, mais celui-ci est plus subtil. Il serait de la région de Rouen, il parle raisonnablement, mais beaucoup trop. Moi, j'ai trop sommeil pour parler.
Départ le lendemain matin, avec arrêt devant un immeuble à la Porte Molitor - tout près de la piscine où je nageais autrefois toutes les semaines - pour prendre un de nos policiers. Le chauffeur monte le chercher. Il ne reste qu'un garde avec nous, debout près de la voiture. Janin, assis à côté de moi - nous avons été séparés tout le temps de notre séjour à Paris - me montre la poche au dos du siège avant. Il y a là un pistolet, d'un modèle que je ne connais pas. Le temps de réfléchir à la situation, de tripoter l'arme - est-elle chargée? armée? où est le cran d'arrêt? Puis-je, menottes aux poignets, abattre l'Allemand debout près de la voiture s'il sort son pistolet? - les deux autres sont là, ils montent, l'un d'eux s'assied entre nous. L'occasion - si c'en était une - s'est échappée. Je me sens bien lent et bien mou. Retour à Loos.
Les jours passent, sans doute, mais le temps est immobile, ou plutôt il tourne en rond: la journée qui commence avec la rentrée du tabouret aux vêtements n'est que celle de la veille qui recommence. Le jeu d'échecs, la leçon d'allemand, la conversation à travers le mur, n'ont ni queue, ni tête: du rembourrage pour emplir le vide. Le calendrier dessiné sur le mur, où chaque jour je trace un bâton, n'a aucun sens. J'ai bien vu, au loin, les feuilles couvrir les arbres; et le soleil hausser sans cesse son arc dans le ciel, et abaisser son ombre sur mon cadran solaire, mais je flotte, suspendu: ma vie est en panne, jusqu'au matin, soudain différent, où elle sombrera.
Vernehmung me convoque rarement à présent, et nous n'échangeons plus que des généralités. Que pense-t-il de la guerre? Ils vont la gagner, ils ont des armes secrètes, terribles. "Vous voulez dire les fusées qui bombardent l'Angleterre? - Bien plus terrible que ça! - Et moi, quel sera mon sort? Vous serez sans doute fusillé." Évidemment. Rien de surprenant. Cette éventualité est présente en mon esprit depuis la décision de revenir en France clandestinement. Elle prend, bien sûr, davantage de place depuis que je suis entre leurs mains. Opérateur radio clandestin, combattant sans uniforme derrière leurs lignes, il n'y a pas grand-chose d'autre à attendre. Un peu d'espoir en une avance foudroyante des Alliés? Un échange? Possible, mais peu probable: une minuscule flamme d'espoir.
A Lyon, nous avions parfois discuté de ce sujet. "Que fais-tu lorsque tu te trouves devant un peloton d'exécution?" Et comme toujours, c'est Maurice Yahiel qui avait la réponse la plus satisfaisante: "S'il y a dans ta vie quelques minutes qui sont à toi, ce sont bien celles-là. Tu fais ce que tu veux. Ris, pleure, fais un bras d'honneur, pisse dans ta culotte, ferme les yeux. Ce temps t'appartient, tu ne dois rien à personne, et tu n'as rien à foutre des images d'Épinal." Je m'y vois. Je voudrais avoir l'air indifférent, lisse, ne pas donner prise...
Nos gardes sont des soldats de l'armée allemande, pas des SS. Quelques jeunes, peut-être blessés en convalescence? Ou bien eux-mêmes punis, en prison? Quelques vieux. La plupart pas méchants, plutôt indifférents, un ou deux même "gentils".
Ma porte s'ouvre un jour, et un soldat, la cinquantaine, celui à qui Cyprien et moi avons collé l'étiquette "le fumeur", à cause de son éternel fume-cigarette, sans cigarette, bien sûr, pendant le service, et qu'il nous dit garder à la bouche pour pallier l'odeur qui lui saute aux narines chaque fois qu'il ouvre la porte d'une cellule pleine d'hommes pas propres, le fumeur me lance un sac en papier. J'y trouve un paquet de tabac, un livret de papier à cigarette et une boîte d'allumettes. Un cadeau de Fassin?
À l'école, mes petits camarades grillaient des cigarettes en se cachant, "pour avoir l'air d'un homme". Je n'avais pas envie d'avoir l'air, et je n'étais pas pressé de ressembler à ceux que je voyais autour de moi. Ma mère aussi fumait. Tout cet argent qui s'en allait en fumée. Alors qu'elle et moi n'avions pas toujours assez à manger. Que trouvaient-ils donc tous à ça? Quel était donc ce plaisir mystérieux, qui me semblait absurde, qui m'échappait?
J'avais là de quoi faire une étude sérieuse, le temps pour la réflexion et la matière première. Je roule, j'allume, j'aspire, je tousse. La première impression était la bonne: c'est absurde et dégueulasse!
A force de se trouver face à face à chaque ouverture de porte une certaine intimité s'établit entre gardiens et prisonniers, d'autant plus qu'en fait ils sont presqu'autant prisonniers que nous, enfermés dans ces murs. Que je sois jeune et rieur, que je sois parachuté de Londres, attire l'attention des soldats. Lorsque Chien Hargneux, le feldwebel, n'est pas sur leur dos, et que le service leur en laisse le loisir, il arrive que l'un d'entre eux ouvre ma porte pour me parler. Je suis un objet de curiosité.
Un jour, alors que les escadrilles passent au-dessus de nos têtes - les avions alliés sont à présent maîtres du ciel et survolent souvent la prison - le "fumeur", qui vient d'ouvrir ma porte, et un jeune soldat qui l'accompagne, me disent, mi-geste mi parole, que nous risquons d'être bombardés. Je réponds en mon allemand tout neuf: "Nein, die sind meine freunde[11]!"
Manque de tact! Ils m'engueulent. Ils ont tous de la famille sous les bombes en Allemagne. Largeur d'esprit surprenante: devant mon air penaud et effrayé, ils se calment et même me rassurent. Nous tombons d'accord: "Krieg Scheisse[12]!"
René Bigot - CYPRIEN - nous a écouté. Il rit d'entendre comment je me sers de son enseignement allemand. Je suis un bon élève. Je parviens même parfois à le battre aux échecs.
Bruit de serrure. "Café". Un des porteurs de bidons me glisse: "Ils ont débarqué cette nuit!" Nous sommes le 6 juin 1944. Deux coups sur le mur. "Allo, CYPRIEN? Tu sais ce qu'on vient de me dire? - Oui, il me l'a dit à moi aussi." L'imagination s'envole, on se voit libéré d'un instant à l'autre!
Et puis le temps passe, les Alliés ont bien du mal à quitter les bords de la Manche. Les promenades dans la prison sont de plus en plus rares. Tourner en rond - vingt, trente minutes - à l'intérieur d'une petite cour triangulaire, en plein air, n'était pas désagréable, après la cellule. J'en suis réduit à une gymnastique entre mes murs, pas drôle.
La guerre patauge autour des plages normandes. Il y a presque deux mois qu'on s'attend à être libérés, et rien ne se passe. Mon interrogateur m'a laissé tomber. À notre dernière entrevue il m'a annoncé la naissance du petit garçon de Fassin et de Solange. "Ici, dans la prison?" Offusqué: "Non, bien sûr, à l'hôpital. Nous sommes des gens civilisés!"
"Ils avancent partout". C'est la phrase rituelle du "téléphone" - cette communication criée par les fenêtres, ou portée par les hommes de corvée, d'une cellule à l'autre - tous les matins. Incantation quotidienne, qui finit par agir, vers le début du mois d'août. Les Alliés font enfin sauter le front allemand et se répandent comme du mercure, Patton vers la Bretagne, Leclerc vers Paris, les Canadiens et les Anglais de Montgomery suivent la côte et remontent vers nous. Cette fois-ci c'est vrai, on va être libérés tout de suite, sinon plus tôt.
Le 16 août 1944, c'est le jour de mon vingt-quatrième anniversaire, et aussi le jour d'un autre débarquement, en Provence celui-là. Les habitudes de la prison sont perturbées. Les Allemands rassemblent ici leurs prisonniers des petites prisons alentour. Pour nous emmener en Allemagne, dit la rumeur. N'importe quoi: comme si les Chleuhs en pleine déroute, qui ont déjà bien du mal à arracher leurs propres hommes à la captivité, allaient s'embarrasser de nous. Comme si les Alliés qui sillonnent le ciel en toute liberté, et la Résistance triomphante, allaient laisser une seule voie de chemin de fer, une seule route à leur libre circulation... Le plus gros risque me semble être qu'un excité nous fusille avant de s'en aller.
Ma cellule est envahie. À présent nous sommes huit. Ce désordre rend le jeu d'échecs quasi impossible. Le 25 août le "téléphone" nous apprend la libération de Paris.
Paris libéré. Sans moi. Des siècles vont s'écouler avant qu'il y ait une autre libération de Paris. Cette joie fantastique dont je suis exclu. On ne peut sans doute pas tous être à Paris: j'aurai droit à la libération de Lille... J'imagine bien ces premiers soldats, exhubérants vainqueurs, presque aussi contents de nous libérer que nous sommes heureux d'être délivrés...
Encore un jour ou deux et ce sera notre tour. Il fait chaud. Il y en a qui ne se lavent pas trop. L'air est épais. Le "fumeur" fait la gueule derrière son fume-cigarette vide, lorsqu'il ouvre notre porte.
Le 30 août, on nous rend nos affaires. Qu'il est satisfaisant d'avoir une ceinture pour retenir son pantalon, et des lacets pour serrer ses souliers!
Le 31, dernier crescendo des serrures. Le "fumeur" ouvre notre porte, fait signe de sortir. Sur la passerelle il y a foule. Les détenus attendent, endimanchés, valises et paquets à la main. Signal de départ. La colonne se met en marche, en piétinant, vers les escaliers.
J'allais passer devant lui, lorsque le "fumeur" ouvre une cellule juste devant moi, la porte ouverte me barrant le chemin. Arrêt. Je ne comprends pas: il n'y a personne à l'intérieur de la cellule. La porte reste ouverte quelques secondes. Le feldwebel, en bas, gueule: "Los! Los! 'runter[13]!" Le "fumeur" referme la porte. Je comprends à sa figure que je suis un abruti. Il essayait de m'extraire du groupe en partance, et je n'ai rien compris!
Descente. Voici la rotonde, sa grille - qui était restée intacte lors du bombardement - est ouverte en grand. Ciel bleu. Je retrouve Raymond Fassin et René Bigot. Mais aucun signe de Solange: il n'y a aucune femme avec nous[14]. Autocar. Embarquement. En route! Nous regardons attentivement autour de nous: la Résistance va surement nous délivrer.
Débarquement dans une gare de triage[15]. Un train de marchandises, cerné de soldats. Il faut y grimper, encouragés par les cris rauques de quelques gradés. Fine poussière grise sur le plancher de notre wagon à bestiaux, un bon centimètre. Du ciment? De l'engrais? Quarante hommes, huit chevaux (en long) dit l'inscription sur la paroi à l'extérieur. Pas de chevaux, mais plus du double d'hommes.
La Croix-Rouge est là. Des dames distribuent des vivres, des encouragements. Ceux qui ont de quoi, écrivent et donnent des messages aux dames. Ne pas s'en faire, disent-elles, la Résistance est prévenue, elle ne laissera jamais passer le train.
L'après-midi touche à sa fin. On ferme les portes coulissantes. Derniers cris d'adieux. Le train s'ébranle. Les wagons de tête, et ceux de queue, portent l'escorte et sont équipés de mitrailleuses. On roule au pas - les Chleuhs se méfient sans doute d'un sabotage - mais on roule. Voici la Belgique, voici la nuit. Les trépidations emplissent l'air de poussière. On a soif, mais pas d'eau. Peu de place, chaque geste touche un voisin. On pisse dans une boite à conserve, qu'il faut vider à travers les barreaux d'une des fenêtres. Ça éclabousse un peu. C'est plus compliqué lorsqu'il s'agit d'un besoin plus sérieux.
Dans un coin, quelqu'un fait un trou, au dessus du tampon, malgré les protestations de ceux qui craignent des représailles, et qui veulent appeler les gardes. Fassin, Bigot et moi, on pèse le pour et le contre. Le train va si lentement qu'on pourrait sauter aisément, mais la cible que nous serions alors aussi serait facile. Il est impensable qu'avec tous ces avions, et la Résistance, le train aille bien loin. Il vaut mieux rester caché dans la masse.
Cris. Coups de fusils. Rafales de mitrailleuses. Freinage brutal. Exclamations rauques à l'extérieur. La porte du wagon s'ouvre. Des Allemands furieux menacent: "Un qui s'évade, dix de fusillés!" Ils installent une sentinelle au bord de la porte, qu'ils laissent ouverte. Le train repart, se traîne, s'arrête à nouveau, repart. La bouche pâteuse de soif et de poussière, je finis par me laisser bercer vers un demi-sommeil. Appuyé aux autres - il n'y a pas la place pour tous s'étendre - je ne pense qu'à boire....
Au matin c'est la Hollande. Grande gare de triage où notre train se pose et attend. Aiguillages. Nombreuses voies parallèles qui brillent au soleil. Sur l'une d'elles un autre train, plein de soldats allemands, qui s'excitent à notre vue, et nous lancent des insultes. Du wagon en face du nôtre partent des coups de feu. Protestations véhémentes de notre sentinelle! Un de mes compagnons a reçu une balle au travers du mollet, montre la blessure à la sentinelle, qui hausse les épaules.
Le train, à présent, roule vite. Le moral est bien bas. Arrêt dans une gare: Aachen - Aix-la-Chapelle. On vient de traverser la frontière allemande. Aix, ça veut dire eau. J'ai soif. Sur le quai il y a une fontaine. Délicieux bruit de l'eau qui ruisselle, et rots de nos gardes qui s'abreuvent et rient de satisfaction. Nous, on repart sans une goutte. Soif. Soif.
Je rumine les occasions offertes de m'échapper, que j'ai laissé filer. Et à quoi jouent la RAF et l'USAF? Et tous ces héros des Résistances française, belge, hollandaise?[16] En train de se soûler la gueule ensemble pour fêter la Libération? Soif. Boire. La soif m'obsède.
Le train ralentit: Köln. C'est Cologne. Le train s'arrête un peu plus loin, dans une gare de triage. Grands cris: "Los! Los!" Il faut sauter des wagons. Le troupeau, entouré de chiens et de soldats, est conduit vers des bâtiments proches, endommagés - sans doute par les bombardements. C'est le Parc des Expositions. Il faut aller sous terre: entrelacs de couloirs et de caves, obscurité.
Un civil vient vers nous, accompagné d'un chien-loup. L'homme est amputé, c'est un SS, il a laissé son bras en Russie, c'est ce qu'il nous raconte dans un long discours rauque où il nous promet que nous allons en baver en Allemagne. De temps à autre il lance le chien sur la masse qui se recroqueville sous l'assaut. Cave voutée, pénombre, chien qui montre les dents et mord ici et là. Ceux qui sont à portée de chien essaient de rentrer dans la masse, qui préfère les garder en écran entre le chien et elle...
Robinet. Je peux boire mon soûl. Rien à manger que les provisions apportées de Lille. Il en reste peu. On dort par terre. Réveil brutal par le manchot et son chien. Long discours méprisant les Français sales: certains d'entre nous ont transformé quelque recoin obscur en latrines. C'est une preuve - mais il n'en avait pas vraiment besoin - que nous appartenons à une race, une civilisation inférieures.
Appel. Un groupe d'entre nous s'en va, on ne sait où. Le reste est assemblé. En route pour la gare de triage, sous escorte, cette fois-ci, de Schupos. Ces flics de ville ont besoin de se défouler et de montrer qu'ils peuvent infliger de la souffrance aussi bien qu'un vrai soldat du front. On grimpe à toute vitesse dans les wagons, sous les coups et les injures, entassés encore plus serrés que dans le premier train.
On roule. Midi. L'après-midi. Le soir. Longs arrêts ici et là. La soif revient. La nuit. Une journée. Je suis abruti, écrasé de fatigue: les trépidations, la poussière, la bouche desséchée, les odeurs, le spectacle de la déliquescence des autres, qui me montre ce que je suis sans doute devenu moi-même...
Une autre nuit commence. Le train s'arrête. Les portes s'ouvrent. Lumière crue des projecteurs sur une gare de triage: celle d'Oranienburg. Encore des chiens, ceux-ci ont des petits manteaux sur le dos, porteurs d'un sigle: SS. Les hommes portent le même insigne que les chiens. Cris. Coups. Les abois des hommes ressemblent à ceux des chiens, eux-mêmes semblables aux SS, cercle vicieux s'il en fut. Hurlements rauques: "Los, mensch! Los! 'raus! Los!" Tous les voyageurs ne sont pas jeunes et souples, et certains tombent, cibles des bottes et des matraques. Gueules haineuses des chiens et des hommes qui cherchent à faire mal. Dans quel lieu de folie sommes-nous donc venus? |
| | [1] Voiture Citroën, de conception révolutionnaire par sa traction avant et son élégance de lévrier parmi les voitures 'cubiques' à propulsion arrière de l'époque. Très populaire à la Gestapo.
[2] Cailloux et bâtons peuvent me briser les os, mais les mots jamais ne me feront de mal.
[3] Il est passé en Espagne le 21 mars 1944.
[4] Les services allemands devaient sans doute souffrir du même surmenage que ceux de Londres: multiplication rapide des "affaires" avec un personnel constant.
[5] Rien n'était pire au monde que la douleur physique. Devant la douleur il n'y a pas de héros, pas de héros...
[6] Petit Robert: ligament cervical du boeuf, durci par dessiccation et étiré, dont on se servait comme d'une matraque .
[7] Pseudo sous lequel j'étais connu à Landrecies.
[8] Il se trouve souvent de bonnes âmes pour reprocher à un prisonnier d'avoir parlé sous la "pression" de ses geôliers, et pour brandir, un peu vite l'accusation de trahison. La résistance de chacun à la torture dépend essentiellement de deux variables intellectuelles, physiques et psychiques: l'habileté du tortionnaire, la capacité du torturé. Certains résistent en se donnant la mort: Pierre Brossolette, René-Georges Weil, peut-être Jean Moulin... ou sont capables de supporter la douleur jusqu'à ce que le bourreau se lasse; d'autres cèdent. Un grand nombre souffrent la question - parfois jusqu'à la mort - parce qu'ils ne connaissent pas la réponse... Un de mes amis opérateur radio a ainsi été accusé, sans la moindre preuve, de trahison après son arrestation par un de nos "Inspecteurs des Transmissions". On peut envisager deux hypothèses:
a) L'accusation est fausse.
b) C'est vrai, il a parlé. Ce jeune homme, en 1940, à l'âge de 20 ans, a choisi de se battre - longtemps avant que l'idée ne vienne à la plupart parmi la minorité infime de Français qui a bien voulu prendre quelque risque - volontaire pour une mission dangereuse en France. Aux mains de la Gestapo, il parle. Et alors?
[9] Vite!, vite!, mec!
[10] J'ai appris, après la guerre, que c'était vrai.
[11] Non, ce sont mes amis .
[12] La guerre, c'est de la merde!
[13] Vite, vite, en bas!
[14] Solange et son bébé n'ont pas été déportés.
[15] j'apprendrai après la guerre que c'était celle de Roubaix..
[16] Je n'ai pas encore compris, en 1990, comment des trains pouvaient ainsi circuler pleins de troupes allemandes et de leurs prisonniers, alors que les Alliés avaient la maîtrise des airs, et que les sabotages de voies ferrées faisaient partie de la vie quotidienne. Etait-ce voulu? Les Alliés préfèrant permettre l'évacuation de l'ennemi pour gagner du temps et ainsi mieux l'affronter en Allemagne, où ils pourraient le bombarder avec davantage de désinvolture? |
| |
|  |
|